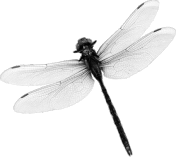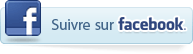|
La
carpe koï

Auteur : Philippe de Vries
Par sa popularité, la carpe koï peut être considérée comme le poisson roi des bassins aquatiques. Sur base de cette popularité, on a fait de ce poisson un véritable commerce où l’on trouve plusieurs variétés.
Toutes les carpes koï sont issues de croisements faits par l’homme, mais pour les distinguer, on parle de classe, de groupe et de variété.

Tout a commencé il y a plus de 2000 ans avec la carpe sauvage à écailles qui est l’ancêtre de la carpe koï.
C’est vers 1912 à l’ère Taisho que l’élevage prit la direction de l’importation et de l’élevage intensif.
Après la deuxième guerre mondiale, les carpes koï ont été importées un peu partout en Europe et les croisements en élevage ont connu un essor foudroyant.
|
D’après certains écrits, la carpe koï fut introduite au Japon en l’an 200 avant J-C, lors des invasions chinoises. Les riziculteurs situés dans un village de Niigata au nord-ouest du Japon introduisirent la carpe dans leurs bassins d’irrigation afin d’avoir du poisson à manger en plus de leur régime à base de riz.
C’est ce village (Yamakoshi go) de la région de Niigata qui devint le centre de l’industrie de la carpe koï d’ornement.
Les livrées étaient principalement des carpes rouges et grises, puis par mutations chromatiques, des carpes koï rouges, blanches et jaune clair ont été produites.
|
Les couleurs, la disposition et le nombre d’écailles, les nageoires de formes ou de couleurs différentes, les différentes tailles en font un des plus beaux poissons d’ornement.
Mais connaissons-nous vraiment ce poisson ? Comment fonctionne-t-il ? Comment réagit-il ?

Je pense que le plus important est d’offrir le meilleur des milieux aquatiques.
Malheureusement, ce n’est pas suffisant, car tous les milieux aquatiques sont de natures biologiquement différentes et tous les milieux comportent des bactéries pathogènes, d’où il est de notre devoir d’apprendre l’anatomie et la physiologie de ce poisson, pour observer, analyser et pouvoir diagnostiquer le moindre problème.
Pour ma part, comme beaucoup de professionnels, il est toujours préférable d’examiner un poisson malade dans son propre environnement et ceci pour la simple raison qu’il sera beaucoup moins stressé. On élimine ainsi plusieurs causes qui pourraient être directement liées au stress.
Pour examiner nos poissons, il est donc de notre devoir d’apprendre la morphologie, les comportements afin de pouvoir diagnostiquer le moindre problème et réagir à temps.
Connaître sa carpe koï, c’est également pouvoir répondre précisément aux questions que l’on se pose ou qu’un spécialiste vous posera, ce qui facilitera le diagnostic en cas de problème.
Voici donc mes connaissances que j’ai couchées sur papier, tantôt dans un langage simple, tantôt plus scientifique, mais l’essentiel à connaître sera dit. Commençons par le début.
|
La
morphologie de la carpe koï |
Grâce à un profil hydrodynamique, la carpe koï nage avec élégance.
La forme du corps est caractéristique de la famille des carpes, il a la puissance qui assure son agilité pour d’avancer dans l’eau.
La partie antérieure du corps est plus large que la partie postérieure, ceci pour réduire les turbulences provoquées par l’eau lors de sa progression dans le milieu aquatique.
C’est dans cette partie plus large que se trouve la plupart des organes importants.
La partie postérieure étant moins large, celle-ci comporte la plus grande masse de muscles dits foncés ou blancs. Ce sont ces muscles qui donnent la puissance à la queue pour faire avancer le poisson.
Quelle grandeur et quel poids peut avoir la carpe koï ?
Voici un tableau où l’on peut déterminer par la longueur le poids approximatif de la carpe koï.
Une carpe koï de
|
10 cm pèse +/- |
60 gr |
|
15 cm |
80 gr |
|
20 cm |
150 gr |
|
25 cm |
300 gr |
|
30 cm |
500 gr |
|
40 cm |
1 kg |
|
50 cm |
2 kg |
|
60 cm |
4 kg |
|
70 cm |
7 kg |
|
80 cm |
10 kg |
Il est important de pouvoir connaître le poids de sa carpe koï pour la distribution de nourriture par exemple mais également pour certains traitements qui sont dosés en fonction du poids.
La carpe koï a cinq sortes de nageoires.
Celles-ci sont d’une grande importance pour assurer la stabilisation dans l’eau et elles permettent au poisson de se diriger avec précision.

Les nageoires pectorales (doubles) et la nageoire caudale (unique) servent à limiter le tangage.
Les nageoires pelviennes (ventrales et doubles) ainsi que les nageoires pectorales (doubles) servent à contrer la propulsion résultant de l’expulsion de l’eau par les branchies, ce qui permet également au poisson de faire surface.
La nageoire dorsale (unique) et la nageoire anale (unique) servent à éviter le roulis et maintenir le cap.
Cette description faite, on comprend que la carpe koï nage en ondulant la queue pendant que les nageoires dorsales et anales, dressées, maintiennent la direction (le cap) et évitent le roulis.
Les petits mouvements des nageoires pectorales permettent au poisson d’avancer avec précision.
Si une ou plusieurs nageoires sont abîmées, on comprendra facilement que c’est toute la stabilité du poisson qui sera compromise. Ce dernier sera désorienté mais aussi stressé.
Ces nageoires, si importantes, sont donc très fragiles. Faites de rayons cartilagineux durs et de parties molles entre les rayons, les nageoires peuvent subir des dommages lors d’un transport, pendant le frai, ou tout simplement en jouant à la course poursuite dans le bassin.
Des bactéries ou champignons, ou encore des parasites peuvent également abîmer les nageoires de la carpe.

Les intoxications dans le milieu aquatique (intoxication à l’ammoniaque ou aux métaux lourds) causent de graves dommages aux nageoires.
Dans tous les cas, si les rayons cartilagineux durs sont atteints, le dommage est permanent. Par contre, si c’est la partie molle de la nageoire qui est atteinte, la régénération de cette partie est possible si le poisson est en bonne santé et dans un milieu aquatique de bonne qualité biologique.
1ère partie : le mucus

Nous savons tous que quand on touche un poisson, il y a cet aspect visqueux parce que les poissons sont recouverts d’une couche de mucus.
Cette substance nommée « mucus » n’est pas un tissu vivant (ce sont des cellules mortes). Le mucus est sécrété par la peau, principalement par les cellules épidermiques. Il est aussi renouvelé en permanence.
Quelle fonction a le mucus ?
-Il sert à transporter les phéromones et les odeurs.
-Il sert à lubrifier le corps pour faciliter la progression et les mouvements aérodynamiques dans le milieu aquatique.
-C’est également une substance antiseptique qui sert à débarrasser le poisson des bactéries, virus, champignons et parasites qui se trouvent dans le milieu aquatique et qui peuvent attaquer la peau. Dans cette substance se trouvent des anticorps naturels (lysozymes qui ont la fonction anti-infectieuse et bactériolysines qui détruisent les cellules bactériennes).

On comprendra facilement qu’il est important de ne pas endommager cette couche de mucus lors de toutes manipulations du
poisson. Si l’on doit manipuler le poisson hors de son milieu aquatique, enveloppez-le poisson dans un linge doux et humide.
Si cette couche de mucus est abîmée, une infection de la peau sera visible. Il faudra déterminer la cause et réaliser un traitement adéquat en n’oubliant pas les stimulants immunitaires tels que les béta-glucanes et le propolis. Ce dernier contient des flavoides qui sont bénéfiques car ils inhibent les infections et stimulent la formation d’anticorps.
2ème partie : la peau elle-même
La peau se trouve sous la couche de mucus, elle est composée en trois parties : l’épiderme, le derme et l’hypoderme.
L’épiderme est pour ainsi dire une couche à part entière composée de cellules épithéliales.

Dans cette couche se trouve :
- des cellules qui déclenchent l’alarme en cas de dommage de la peau
- des cellules muqueuses cupulaires
- des globules blancs
- des leucocytes qui se multiplient en cas d’infection.
Le derme est une structure fibreuse et solide contenant :
– les cellules pigmentaires chromatophores (ces cellules donnent la couleur au poisson) donc la livrée(*) du poisson
– les écailles se formant dans cette structure.
* Livrée = couleur de la robe suivant la variété biologique

L’hypoderme est de structure moins solide et relie la peau aux muscles et aux os.
Dans cette structure, il y a une excellente irrigation sanguine, ce qui permet entre autre une bonne dispersion des infections bactériennes.
Dans la couche du derme et de l’hypoderme se trouvent dispersés sur le corps des nerfs, le tissu conjonctif et certains organes sensitifs.
|
Les
couleurs de la carpe koï |

C’est dans la peau et plus précisément dans le derme que se situent les cellules pigmentaires qui déterminent les couleurs de la carpe koï.
Les éleveurs, les professionnels, juges de concours et les amateurs éclairés utilisent des mots japonais pour chaque couleur, ce qui donne le nom des variétés et catégories différentes pour les carpes koï.
Voici une liste de mots japonais les plus couramment utilisés :
|
Ai |
Bleu |
|
Aka Rouge |
(couleur de fond) |
|
Beni |
Rouge orangé (généralement pour la couleur de fond) |
|
Cha |
Brun |
|
Gin |
Argent (métallique) |
|
Hi |
Rouge (marques sur le corps) |
|
Karasu |
Noir (couleur de fond) |
|
Ki |
Jaune |
|
Kin |
Or (métallique) |
|
Midori |
Vert |
|
Nezu/ Nezumi |
Gris (gris souris) |
|
Orenji |
Orange |
|
Shiro |
Blanc |
|
Sumi |
Noir (marques noires sur le corps) |
|
Yamabuki |
Jaune (jaune pâle) |
Scientifiquement, on sait que dans les cellules pigmentaires il y a :
- les érythrophores qui sont responsables de la pigmentation rouge et orange
- les iridophores qui sont des cristaux reflétant la luminosité
- les xanthophores qui donnent la pigmentation jaune
- les mélanophores qui donnent la pigmentation noir et brune.
Toutes ces cellules sont prioritaires selon la génétique du poisson.
Les couleurs varient et sont déterminées par les parents génétiques. Cependant, la qualité d’environnement, la nourriture et la qualité de l’eau (principalement le pH) détermineront définitivement les couleurs.
Par exemple, une eau douce favorise la teinte rouge, par contre le noir sera moins intense et se développera moins vite. Le blanc sera également moins clair.
Dans une eau dure (pH 7,5 et 8,5), le noir et le blanc seront plus clairs, plus intenses et plus parfaits.
Dans l’alimentation, certains éleveurs professionnels ajoutent de la carotène
qui renforce la pigmentation du rouge mais attention cet additif fait virer les parties blanches vers le rose !
Un autre additif ajouté est la Spirulina qui ravive également le rouge et limite le virage du blanc au rose. Il est ajouté à la nourriture durant un mois sur l’année, généralement en septembre.
On peut cependant donner cet additif à n’importe quelle période de l’année, mais à condition que la température soit supérieure à 10°C.
Pour la couleur rouge et jaune, une forte présence de phytoplancton vert (algues unicellulaires) dans le bassin est favorable.
Pour l’aspect général des couleurs, on peut donner de temps en temps des crevettes entières avec les carapaces. Celles-ci ravivent de façon générale les teintes
de la robe de la carpe koï.
Attention toutefois qu’une surdose de Spirulina peut entraîner des troubles du foie et de la rate.
Actuellement, seuls les professionnels de concours donnent ces additifs avant de faire concourir leur carpe koï, cela afin de renforcer les couleurs.
Généralement, tous les aliments de marque contiennent la dose suffisante de carotène et Spirulina.
A suivre ...
N'hésitez
pas
à
communiquer
vos
découvertes
et
expériences
via
le
forum
ou
en
contactant
l'équipe
Aquajardin.
|